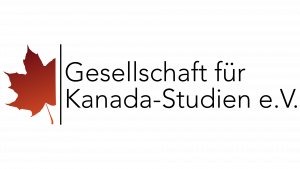“Intersectionality: Theories, Policies, Practices”
February 14-17, 2019, Grainau, Germany
40th Annual Conference of the Association for Canadian Studies
in German-Speaking Countries (GKS)
The Association for Canadian Studies in German-Speaking Countries is a multidisciplinary academic association which aims to increase and disseminate a scholarly understanding of Canada. For our 2019 annual conference, we invite papers from any discipline that speak to the conference theme of “Intersectionality: Theories, Policies, Practices” with a Canadian or comparative focus. (Papers can be presented in English, French or German.) We are particularly – but not exclusively – interested in the following four main aspects:
- Beyond Race, Class, and Gender: Historical, Sociological, Geographical, and Political Dimensions of Intersectionality
- Space and the Politics of Place: Location, Environment, Cross-Border Dynamics
- Intersectionality and Education
- Intersectional Approaches: Discourses, Representations, Texts.
Intersectionality, “both an analytical framework and a complex of social practices” (Hancock 2016: 7), has its roots in U.S. Black feminism, where, since the late 1980s, it has been used to address issues of inequality such as disparate access to social resources. While applicable to both individuals and groups, intersectionality focuses on interlocking categories of difference and their impact on a plethora of decision-making processes. Apart from race, gender, and class, the following mutually constitutive categories have been proposed: ethnicity, sexual orientation, age, bodily ability, religion, education, culture, nationality/citizenship status, language use as well as geographical and environmental location. Next to the relationship between categories, internal differences within categories have been considered, with scholars trying to assess power relations, for instance in terms of voice and agency, and thus identifying advantaged and disadvantaged social positions. Over the years, intersectionality has not only developed into a key concept of women’s and gender studies, but left its mark in many other disciplines, among them history, political science, geography, sociology, psychology, philosophy, cultural studies, and postcolonial studies.
In Canada, the experience of discrimination shaped by multiple identities has been recorded in volumes such as Maria Campbell’s Halfbreed (1973), Makeda Silvera’s Silenced (1983), Monique Proulx’s Le sexe des étoiles (1987), Dionne Brand’s No Burden to Carry (1990), or Orville Lloyd Douglas’s Under My Skin (2014). During the time span covered by these publications, Canada witnessed an increasing institutionalization of intersectionality. Scholarly analyses of Canadian society through an intersectional lens no doubt contributed to this development. Thus Olena Hankivsky and Renée Cormier pointed to health inequities which, for instance, deny Aboriginal women in nonurban environments vital health care services (2009: 16) and Rita Dhamoon underlined the importance of intersectionality for Canadian solidarity politics (2009).
Recent trends in intersectionality research include, first, a more balanced view on processes of marginalization and privileging, acknowledging that a particular group or person might be disadvantaged in one social context but advantaged in another, and, second, a more nuanced perspective on visibility, which is no longer seen as an asset in its own right. Depending on the circumstances, invisibility might lead to beneficial societal positions and might thus be an individual’s or group’s choice. The creative use of multiply-encoded identities at a particular time in a specific social location calls for a more dynamic concept of intersectionality, one that allows including transnational experiences.
Contact and abstract submission:
Paper proposals/abstracts of max. 500 words should outline:
- methodology and theoretical approaches chosen
- content/body of research
- which of the four main aspects outlined above the paper speaks to (if any).
In addition, some short biographical information (max. 250 words) should be provided, specifying current institutional affiliation and position as well as research background with regard to the conference topic and/or four main aspects.
Abstracts by established scholars should be submitted no later than May 31, 2018 to the GKS administration: gks@kanada-studien.de.
Abstracts by emerging scholars should be submitted no later than May 31, 2018 directly to the Emerging Scholars Forum: nachwuchsforum@gmail.com.
Download the Call here.
« Intersectionnalité : Théories, Politiques, Pratiques »
Du 14 au 17 février 2019 à Grainau, Allemagne
40ème Conférence annuelle de l’Association des études canadiennes
dans les pays germanophones
L’Association des études canadiennes dans les pays germanophones est une association académique multidisciplinaire qui vise à accroître et à diffuser les recherches scientifiques sur le Canada. Notre conférence annuelle 2019 est ouverte à des propositions de communication sur le Canada venant de toute discipline universitaire, sur le thème : « Intersectionnalité : Théories, Politiques, Pratiques ». (Les communications peuvent être présentées en anglais, français ou allemand). Nous souhaitons mettre particulièrement l’accent, mais pas exclusivement, sur les quatre aspects principaux suivants :
- Au-delà de la race, de la classe sociale et du genre : dimensions historiques, sociales, géographiques et politiques de l’intersectionnalité
- L’espace et la politique de l’espace : lieu, environnement, dynamiques transfrontalières
- Intersectionnalité et éducation
- Approches intersectionnelles : discours, représentations, textes.
L’intersectionnalité est qualifiée par Hancock (2016 :7) comme : « both an analytical framework and a complex of social practices ». Celle-ci trouve ses racines aux États-Unis dans le féminisme noir américain où elle a été utilisée pour aborder les problèmes liés à l’inégalité, comme l’accès inéquitable aux ressources sociales. Bien qu’applicable aux individus comme aux groupes, l’intersectionnalité se concentre sur les interdépendances de catégories marquant la différence et leur impact sur une multitude de processus de décision. Outre la race, le sexe ou la classe sociale, les catégories respectivement constitutives suivantes ont été proposées : ethnicité, orientation sexuelle, âge, capacité physique, religion, éducation, culture, nationalité/citoyenneté, langage ainsi que l’emplacement géographique et environnemental. En liaison avec les relations entre ces catégories, les différences internes de ces catégories ont été analysées par les chercheurs afin de dégager des rapports de pouvoir, par exemple en termes de prise de parole et de possibilité d’action ; et par conséquent d’identifier ainsi des positions sociales avantagées ou désavantagées. Au fil des années, l’intersectionnalité est non seulement devenue un concept fondamental dans les études sur les femmes et le genre, mais elle a aussi laissé sa trace dans d’autres disciplines ; notamment l’histoire, les sciences politiques, la géographie, la sociologie, la psychologie, la philosophie, les études culturelles et les études postcoloniales.
Au Canada, l’expérience de la discrimination due à des identités, multiples a été recueillie dans des livres comme Halfbreed (1973) de Maria Campbell, Silenced (1983) de Makeda Silvera, Le sexe des étoiles (1987) de Monique Proulx, No Burden to Carry (1990) de Dionne Brand’s, ou encore Under My Skin (2014) d’Orville Lloyd Douglas. Durant la période où ces publications sont apparues, l’intersectionnalité a connu une institutionnalisation grandissante au Canada. Des études sur la société canadienne à travers le prisme de l’intersectionnalité ont sans doute contribué à cette évolution. Olena Hankivsky et Renée Cormier ont ainsi mis l’accent sur les inégalités dans le système médical qui, par exemple, refuse des traitements médicaux d’importance vitale à des femmes indigènes habitant en milieux non urbain (2009 :16). Et Rita Dhamoon a elle aussi souligné l’importance de l’intersectionnalité pour la politique canadienne de solidarité (2009).
Les orientations récentes dans les recherches sur l’intersectionnalité offrent un regard plus équitable sur les processus de marginalisation et d’attribution de privilèges, reconnaissant qu’un groupe particulier ou une personne pourraient être désavantagés dans un contexte social et avantagés dans un autre. Par ailleurs, cette tendance comprend une perspective nuancée concernant la visibilité des différences qui ne représente plus un atout à part entière. Selon les circonstances l’invisibilité des différences pourrait mener à une position sociale avantageuse et ainsi être un choix individuel ou de groupe. L’emploi créatif d’identités encodées de façons multiples à un moment donné dans un milieu social spécifique incite à concevoir un concept beaucoup plus dynamique de l’intersectionnalité, un concept qui permet d’inclure les expériences transnationales.
Contacts et soumission des résumés :
Propositions de communication/résumés contenant au max. 500 mots soulignant :
- La méthodologie et les approches théoriques choisies
- Le contenu et le corpus de la recherche
- L’aspect traité par la proposition de communication parmi les quatre aspects mentionnés ci-dessus (si c’est le cas)
De plus doivent être fournies quelques brèves informations biographiques (max 250 mots), spécifiant l’actuelle affiliation institutionnelle, la position du chercheur ainsi que les liens de ses recherches avec le thème de la conférence et/ou les quatre aspects principaux mentionnés.
Les résumés des chercheurs confirmés doivent être soumis au plus tard le 31 mai 2018 à l’administration du GKS : gks@kanada-studien.de.
Les résumés des jeunes chercheurs doivent être soumis au plus tard le 31 mai 2018 au forum des jeunes chercheurs : nachwuchsforum@gmail.com
appel à communication pour télécharger.