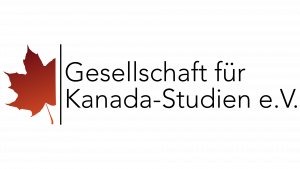Problématique : « Le travail dans la littérature québécoise contemporaine »
« Le travail, c’est bien une maladie, puisqu’il y a une médecine du travail », disait Coluche en 1995. Au-delà de l’humour, la citation révèle une conception négative du travail et affirme l’exact opposé de l’adage populaire « le travail, c’est la santé ». En effet, avec l’industrialisation d’abord, puis avec l’essor du néolibéralisme et la précarisation récente de l’emploi, le travail est plus souvent perçu comme une source de souffrance qu’un vecteur de bien-être. Au tournant des années 1980 en France, Dominique Viart parle d’un réveil de la littérature du travail (2011) qui « accuse autant qu’[elle] met en forme une idée de perte généralisée, dont l’aboutissement est la précarité grandissante – du travail et de l’expérience humaine qu’il génère » (David, p. i). Alors que le constat est sensiblement le même de l’autre côté de l’Atlantique, il est très peu question de « la job » dans la critique littéraire québécoise. C’est à cette question de la représentation (ou de l’absence de représentations) du travail dans le théâtre, la poésie, la bande dessinée, l’essai et le roman québécois que le premier numéro de FÉMUR sera consacré.
De Jean Rivard le défricheur aux Pensées pour jours ouvrables de Bureau Beige (2017) en passant par Le cassé (1964), Môman travaille pas, a trop d’ouvrage (1976) et les nombreux romans historiques qui prennent pour décor un Québec ouvrier du siècle passé, le travail prend plusieurs formes et occupent différentes fonctions (narratives, identitaires, idéologiques, critiques) qui ont surtout été étudiées sous l’angle de la sociocritique et de la sociologie. Central à certaines conceptions féministes (Toupin, 2014) et marxistes de la société, le travail (et son envers le chômage, par exemple) conserve en effet, dans les œuvres et dans la critique littéraire québécoise, une profondeur historique qui en fait un objet politique ou à tout le moins, un objet qui problématise les liens entre littérature et politique. À ce titre, le joual, qui domine les représentations des milieux populaires à Parti pris notamment, illustre bien cette jonction entre projet littéraire et projet politique (marxisant), à l’horizon d’une poétique du travail spécifique. Des décennies plus tard, des questions similaires, à propos de l’engagement de l’oeuvre et de l’écrivain, de l’oralité et de la fonction critique de la littérature, se posent à la lecture de l’oeuvre romanesque et poétique d’Érika Soucy (Les murailles, L’épiphanie dans le front), des Confessions d’un cassé (2015) ou des Contes du travail alimentaire (2011), mais aussi d’un texte comme Retraite de Renaud Jean (2014), qui opère une critique de la doxa économique par l’entremise du motif de l’ennui et de la retraite.
Suivant en cela les changements économiques qui amènent de nouvelles « normes » et « formes » de travail, un grand nombre de Québécois⋅es se trouvent dans l’obligation d’occuper des emplois atypiques (pigiste, travail « par projets », contrats, temps partiel, intérim, stages, travail « au noir », à domicile, de nuit, etc.). Quelle place les œuvres québécoises contemporaines réservent-elles à ces travailleurs⋅euses précaires ? Quel portrait les textes dressent-ils de la main d’oeuvre issue des régions plus éloignées, dont les possibilités d’avenir sont dictées par les réalités propres au territoire habité ? Et qu’en est-il des femmes qui, malgré leur « présence accrue sur le marché du travail depuis le dernier siècle », assument toujours « les deux tiers des corvées domestiques » (Hamrouni, p. 2) ? Entendu comme l’ensemble des activités et des soins prodigués pour assurer le maintien du bien-être d’une personne, le care rendu par les femmes fait-il l’objet de représentations dans la littérature québécoise ? S’apparente-t-il à une forme de travail ou est-il plutôt décrit en termes de choix personnel, voire de vocation propre à la gent féminine ?
Sur les plans esthétiques et poétiques, les littératures du travail soulèvent également plusieurs interrogations. Perçu comme routinier, le quotidien des travailleurs⋅es laisse parfois difficilement place à l’événement et appelle une langue répétitive ou technocratique. Comment les oeuvres s’accommodent-elles de cette monotonie ou, au contraire, de la contrainte de la productivité tous azimuts ? Existe-t-il, au sein de certains projets littéraires, « un caractère expérimental [qui s’efforce de traduire] la “novlangue néolibérale” (Krzywkowski, p. 73) » ? Conjointement à la question de l’écriture se pose celle du rapport à la réalité : certains genres sont-ils privilégiés pour relater l’expérience du travail (romans historiques, formes hybrides, formes dramatiques, fictions documentaires, biographies, récits, témoignages, etc.) ? Quelle valeur l’institution leur accorde-t-elle ; y a-t-il un « coût symbolique » élevé aux représentations du travail ? Enfin, au-delà du projet de représentation, les littératures du travail comportent-elles d’autres visées ? Quelle conception de la littérature et de ses « pouvoirs » mettent-elles en jeu ?
The full Call for Proposals can be found here.
Date de tombée : 31 juillet 2018.