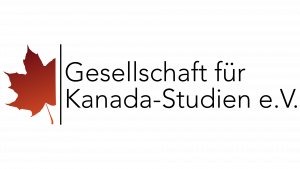Université du Québec à Montréal, 22 septembre 2023
Date limite pour soumettre une proposition : 31 mars 2023.
La relation du Québec au colonialisme reste irrésolue. Une littérature scientifique a pensé le Québec en mettant de l’avant une sociologie dite « des petites nations ». On y souligne, notamment de manière comparative, les tensions et les ambiguïtés propres à l’analyse de sociétés tantôt minorisées et tantôt colonisatrices (Bouchard 2000; Laniel et Thériault 2020). Or, cette première caractéristique, laquelle met en lumière un Canada francophone pétri par les impérialismes européens et produit d’une mobilisation institutionnelle qui vise à assurer sa pérennité, a été davantage étudiée que la seconde, laquelle sous-entend plutôt un projet colonial distinct souvent associé à l’expansion territorial de l’État québécois.
Le Québec peut en effet être décrit comme « maîtres chez l’Autre », pour reprendre la formule d’Emilie Nicolas (2020). Dans les deux derniers siècles, l’écoumène québécois, d’abord restreint aux territoires de la vallée du Saint-Laurent et aux terres qui longent la frontière américaine, prend des proportions continentales. La constitution concomitante des ressources naturelles et du territoire comme objets de savoirs étatiques à des fins de contrôle, d’inventaire et de développement capitaliste devient, dans une certaine mesure, l’assise d’une prospérité matérielle qui s’accompagne de l’accaparement de ressources, de l’occupation de nouveaux territoires et de la dépossession conjointe de communautés autochtones (Desbien 2014; Gettler 2016; Loo 2016; Castonguay 2016). Même là où l’établissement de colons remonte au 17e siècle, lorsque mesurée à l’aune de la présence humaine en Amérique du Nord, cette occupation apparaît de plus toute récente. De manière plus contemporaine, le mouvement « Idle no more » et ses suites, l’opposition au développement de la rivière Magpie, les luttes mémorielles (Savard et Beauchemin 2018), les débats sur la notion de racisme systémique et la remise en question de modes de négociations habituels (Ross-Tremblay et Hamidi 2013) ont, par exemple, mis en exergue dans le présent la pertinence du concept de colonialisme. Le leg et la mémoire des pensionnats pour autochtones demeurent notamment largement absents dans la recherche scientifique francophone même si au centre d’interventions culturelles et artistiques autochtones au Québec depuis plusieurs décennies (Henzi 2017).
Des chercheurs et des chercheuses tentent d’ailleurs de faire du colonialisme un thème central de l’étude du Québec francophone (Choquette 2017; Larochelle et Hubert 2019; Villeneuve 2022). D’autres soulignent également le besoin d’élargir les référents comparatifs tout en reconnaissant que malgré son caractère de « société neuve », le Québec reproduit les rapports de domination de l’Ancien Monde (Stasilius et Jhappan 1995, Couture 2000, Cardinal et Papillon 2011) et ainsi les contradictions inhérentes aux aspirations émancipatrices de plusieurs mouvements nationalistes (Giroux 2020). Le colonialisme apparaît donc à la fois comme une notion qui, dans sa spécificité québécoise, demeure à cerner et comme un concept opératoire permettant d’ouvrir de nouveaux horizons méthodologiques.
Cette journée d’étude a donc pour ambition de problématiser, dans une perspective interdisciplinaire, le colonialisme comme thème d’analyse structurant pour l’étude de dynamiques sociales, intellectuelles, économiques, politiques et historiques sur les territoires du Québec contemporain.
En plus de s’interroger sur les pratiques et les effets de la colonisation et de l’occupation du territoire en contexte québécois, nous souhaitons aborder dans cet atelier la question du colonialisme largement pour faire référence, par exemple, à diverses formes de domination et d’occupation, aux expériences plurielles de résistance et d’adaptation qui les accompagnent, à la construction d’altérités et d’imaginaires, à la commodification à grande échelle des terres publiques ou aux grandes dynamiques économiques et transnationales, dont la mondialisation des capitaux et des idées, que plusieurs historiographies associent au colonialisme (Drayton et Motadel 2019).
Nous enjoignons, par exemple, les participant.e.s à se pencher sur des thèmes tels :
- Accaparement du territoire, territorialité et rapport à la terre
- Les théories du colonialisme et les approches décoloniales dans le contexte québécois
- Ceux et celles qui vivent la colonisation ou le colonialisme; leurs expériences, résistances et influences
- Les comparaisons entre le Québec, le Canada ou d’autres espaces
- La gouvernance autochtone
- Les imaginaires et référent historiques véhiculés par la société civile, les agents et les institutions de l’État
- Les tensions de la dichotomie Québec colonisé; Québec colonisateur
Le colloque se tiendra à l’UQAM le vendredi 22 septembre 2023. Celles et ceux intéressé.e.s. à soumettre une proposition de communication sont prié.e.s d’envoyer un résumé de 400 mots à Martin Crevier : crevier.martin.2[at]courrier.uqam.ca d’ici le vendredi 31 mars 2023.
Comité organisateur
Éléna Choquette (UQO)
Martin Crevier (UQAM)
Martin Papillon (Université de Montréal)
Stéphane Savard (UQAM)